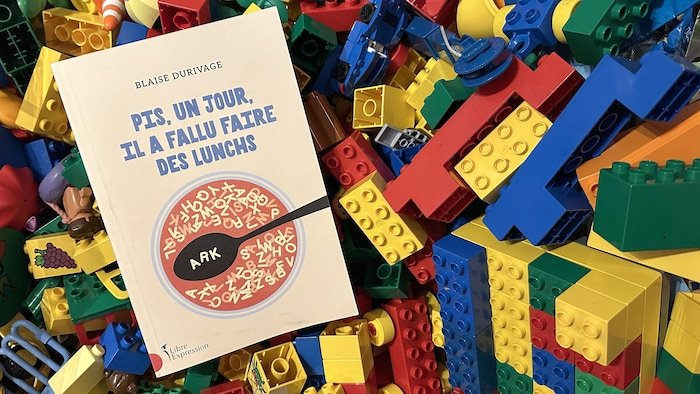Tout lire sur: Radio-Canada Livres
Source du texte: Lecture
Blaise Durivage et Julie Benoît ne sont pas les premiers auteurs à s’inspirer de leur quotidien pas toujours glorieux de parent pour écrire. Les deux le font toutefois avec une capacité d’introspection et d’observations sociales empreintes tantôt de suave ironie, tantôt de dérision pour le moins décapante.
Ce faisant, ils proposent également leurs premiers livres : Pis, un jour, il a fallu faire des lunchs et Ce qui se passe en moi aura lieu de toute façon, respectivement publiés aux éditions Libre Expression et Quartz.
Être Dada pour ses enfants
Blaise et Philippe se tourneront vers l’adoption pour devenir Dada et Papa pour leurs deux garçons.
Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard
Pis, un jour, il a fallu faire des lunchs, c’est l’histoire d’un couple d’amoureux qui s’est d’abord trouvé du regard, avant d’envisager de devenir parents et d’adopter deux fois plutôt qu’une.
En prêtant son prénom à son héros, Blaise Durivage ne cache pas qu’il signe un premier roman à saveur hautement autobiographique, dans lequel il raconte avec beaucoup d’humour comment il a très tôt su et assumé qu’il était gai. Et surtout comment, des années plus tard, il a cru un brin naïvement qu’à titre d’enseignant, il saurait être une bonne maman
pour ses enfants, y compris si l’un d’eux arrivait dans sa vie avec des besoins spéciaux.
Blaise Durivage se fait donc appeler Dada par ses deux garçons, puisque le papa de la famille, c’est sans contredit son conjoint, Philippe.
Je savais qu’on se demandait bien qui était mon conjoint, comment on avait eu des enfants, qui faisait le père, qui faisait la mère. Je ne pouvais pas faire disparaître les préjugés chez les autres parce qu’ils m’habitaient, moi avec.
Si le ton utilisé s’avère joyeusement décomplexé, il n’est jamais complaisant pour autant.
Blaise Durivage se livre ici sans gêne et sans fard, qu’il évoque les inévitables questionnements sur la répartition des rôles au sein d’un couple gai ou qu’il fasse état de ses angoisses quant à sa capacité à faire partie du cercle des mamans croisées au parc ou à l’école. Qu’il s’en prenne aux influenceuses, pour qui la maternité ne semble jamais inclure la fatigue accumulée – ni les cernes sous les yeux! – dans leurs publications, ou encore qu’il témoigne des hauts et de la baisse de libido entre son personnage et son chum.

De sa plume décomplexée, Blaise Durivage traite d’homoparentalité aussi bien que de la réalité d’accompagner un enfant autiste dans son développement.
Photo : Gracieuseté des éditions Libre Expression / Philippe Ouimet
Son sens aiguisé de l’autodérision permet ainsi à l’auteur de faire (sou)rire le lecteur souvent. Il lui donne aussi l’occasion de le confronter par la bande à la réalité insécurisante de l’adoption en banque mixte et de l’accompagnement d’un enfant autiste dans son développement, entre autres.
Pis, un jour, il a fallu faire des lunchs révèle surtout le quotidien d’une famille qui s’aime. Parfois un peu tout croche, mais avec une sincérité par moments désarmante d’absurdité normale… ou de normalité absurde, comme la scène d’ouverture du livre en fait foi. Au bout du compte, c’est d’ailleurs ce qui fait tout son charme!
Maternité sous bistouri
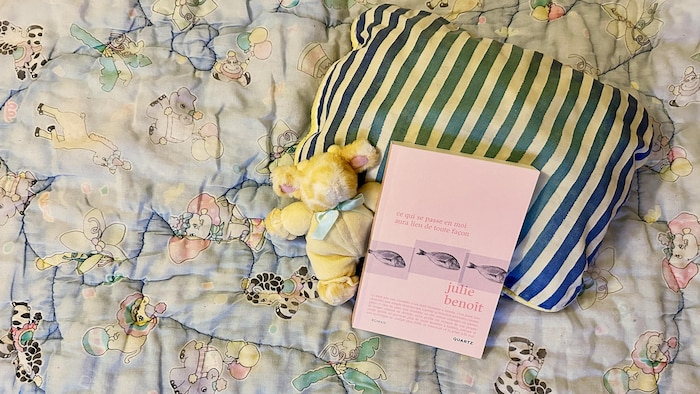
Pour Suzanne, l’héroïne de Julie Benoît, rien ne se passera comme prévu lors de son accouchement.
Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard
Dans ce qui s’avère également son premier roman, Ce qui se passe en moi aura lieu de toute façon, Julie Benoît joue aussi d’un humour tour à tour mordant et pince-sans-rire pour parler de maternité. Une maternité que son héroïne, Suzanne, remet quant à elle fortement en question dans l’espoir de reprendre le contrôle sur son existence. Ou, en tout cas, d’y reprendre pied si possible.
A priori, Suzanne n’était pas certaine de vouloir un enfant. Et la venue au monde de sa fille ne fait qu’exacerber ses peurs de ne pas être à la hauteur des attentes : celles de son bébé et les siennes, bien sûr, mais aussi celles de la société.
Si Julie Benoît manie littérairement le scalpel dans son texte, c’est parce que Suzanne, elle, dissèque avec une précision chirurgicale et une lucidité implacable ses émotions et interrogations, ainsi que la banalisation de la souffrance des femmes, relativement à cette naissance pendant laquelle rien ne s’est passé comme prévu.
Le plafond défile rapidement et les portes battantes s’ouvrent avec fracas. La scène est digne de E.R. ou de Grey’s Anatomy, mais personne n’est séduisant et il n’y a absolument aucune cote d’écoute sauf pour les quelques personnes dans le couloir qui se rangent brutalement contre les murs au passage du cortège.
Car ce qui devait être un moment inoubliable dans sa trajectoire de femme s’est transformé en césarienne d’urgence. Suzanne garde donc peu de souvenirs de l’événement, si ce n’est la présence d’un bel anesthésiologiste. Et une cicatrice au ventre qui, elle aussi, s’estompera puisqu’elle a pu compter – sans le savoir! – sur une étudiante en obstétrique aux doigts de fée pour la recoudre.

Par son roman, Julie Benoît cherche notamment à déboulonner la honte de donner naissance par césarienne.
Photo : Gracieuseté des éditions du Quartz / Justine Latour
Dès lors, Suzanne n’aura de cesse de se poser les mêmes questions. De ressasser ce qui s’est passé ce jour-là –ou pas – pour tenter de donner un sens à sa nouvelle vie à deux.
Une césarienne équivaut-elle à un accouchement raté
? Pire, peut-elle invalider son expérience de mère, étant donné qu’elle n’a pas mis sa fille au monde par voie naturelle et encore moins sans anesthésie, comme le prétendent certaines femmes sur les réseaux sociaux?
Son désir de dormir, la nuit, fait-il d’elle une personne égoïste ne pensant qu’à son propre manque de sommeil? Où s’arrête la culpabilité quand on fait rimer biberon avec dépression? Et est-ce normal de vouloir reprendre le travail pour parler à d’autres adultes?
Ces questionnements existentiels de Suzanne sont sans contredit drôlement pertinents, et tout aussi impertinents, dans la façon même dont Julie Benoît les expose sans fausse pudeur.
Seul bémol : ils relèvent à ce point de l’obsession pour l’héroïne que le lecteur finit par avoir l’impression de tourner un peu en rond. Comme si les touches d’humour autrement jouissives de l’autrice perdaient peu à peu leur capacité à contrer les effets lancinants de ce vortex post-partum.
Cela dit, avoir des enfants ressemble parfois à se retrouver au cœur d’une tornade et à devoir déplacer son centre de gravité pour continuer d’avancer et donner sens à sa réalité. Un pas à la fois, à l’instar de Suzanne lorsqu’elle sort marcher seule. Ou une phrase à la fois, comme Julie Benoît l’écrie et l’écrit.