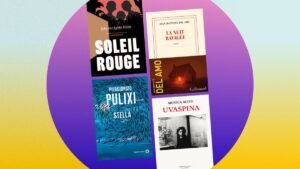Tout lire sur: L'actualité culture
Source du texte: Lecture
Depuis sa participation au téléroman Unité 9, où elle interprétait la détenue Eyota Standing Bear, pas une semaine ne passe sans que Natasha Kanapé Fontaine se fasse arrêter et remercier partout où elle va, des rues de Montréal au centre commercial. « Ce personnage a ouvert les yeux de bien des gens sur la réalité autochtone au Québec. »
Consciente du pouvoir de la fiction, l’écrivaine et comédienne innue lance en novembre son premier roman, Nauetakuan : Un silence pour un bruit (XYZ). Elle suit ainsi la voie tracée par plusieurs de ses compatriotes qui sont très populaires auprès des critiques et des lecteurs.
Le roman Kukum (Libre Expression, 2019), de Michel Jean, lauréat du Prix littéraire France-Québec 2020, trône au sommet des palmarès des livres les plus vendus chaque semaine ou presque depuis près d’un an. Avec plus de 100 000 exemplaires, il rejoint d’autres succès tels que La femme qui fuit (Marchand de feuilles, 2015), d’Anaïs Barbeau-Lavalette, et Ru (Libre Expression, 2009), de Kim Thúy. Le huitième roman de Michel Jean, Tiohtiá:ke, a été lancé en octobre 2021.
Naomi Fontaine, qui marche sur les pas d’auteurs confirmés, parmi lesquels Marc Séguin (La foi du braconnier, Leméac, 2009) et Éric Dupont (La fiancée américaine, Marchand de feuilles, 2012), a pour sa part remporté le Prix littéraire des collégiens en 2020 avec Shuni (Mémoire d’encrier, 2019). L’adaptation de son bouquin Kuessipan (Mémoire d’encrier, 2011) au grand écran, en 2019, cumule les éloges de la critique, ayant raflé des prix au Canada, en France et en Belgique.
La littérature innue a le vent dans les voiles. Depuis 2010, pas moins de 12 romans et 18 recueils de poésie ont été publiés ou réédités, selon le répertoire de l’organisme Kwahiatonhk !, qui fait la promotion de la littérature autochtone. Il y en avait eu six entre 1980 et 2009, tous genres confondus. Une dizaine de romanciers et de poètes innus sont présentement actifs sur la scène littéraire, ce qui fait de cette communauté la plus prolifique des Premières Nations du Québec. Bien que les Hurons-Wendats possèdent également un corpus important, ils sont loin d’obtenir la même visibilité.
Cette prépondérance s’explique en partie par le fait que les Innus forment la Première Nation la plus nombreuse sur le territoire québécois. Le français est leur langue première ou seconde, ce qui facilite les liens avec les institutions culturelles établies.
Les sujets difficiles ne manquent pas dans les œuvres de ce premier peuple : dépendance, dépression, itinérance, pensionnats pour Autochtones, dépouillement identitaire, femmes et enfants disparus… « C’est facile de porter des jugements sur les communautés autochtones et sur les problèmes qu’elles rencontrent, souligne l’écrivain et journaliste Michel Jean. Avec la fiction, on a le pouvoir de toucher les gens et de leur permettre de marcher un peu dans les mocassins de quelqu’un d’autre. Avec Kukum, je voulais que les Québécois comprennent que ce qu’on voit aujourd’hui est la conséquence de la sédentarisation forcée, qu’ils le ressentent. »
Si la littérature constitue un premier pas vers une réconciliation entre les Autochtones et les allochtones, elle représente aussi un espoir de guérison et de résistance pour les principaux intéressés.
« J’écris d’abord et avant tout pour permettre aux Innus d’être fiers de leur histoire, de leur culture, et même de leurs failles, dit Naomi Fontaine. Par le passé, on a souvent échoué à rester debout. La réconciliation, elle commence avec nous-mêmes. On ne peut tendre la main à l’autre si on n’est pas dans l’affirmation et le respect de soi. »
Après avoir vécu de près les conséquences de la dépossession territoriale et culturelle, bon nombre d’auteurs innus perçoivent l’écriture comme une démarche de réappropriation. « J’écris dans la perspective de reprendre les rênes de mon histoire et de mon imaginaire, et non pour jeter un blâme ou pour m’opposer à ce qui est différent de moi, explique Natasha Kanapé Fontaine. Les lecteurs québécois me remercient souvent de leur tendre la main et de les entraîner doucement dans ma réalité. »
Que leurs récits se déroulent en ville ou dans la forêt boréale du Nitassinan, au passé ou au présent, les écrivains innus font rayonner leur culture, leur mythologie et leur rapport sacré à la nature.
« Pour les Innus, l’homme s’inscrit dans le territoire dans un rapport d’égalité avec la forêt, la faune et la flore, souligne Michel Jean. Ils conçoivent le monde comme un cercle plutôt que comme une ligne droite qui nous mène toujours vers l’avant. Je pense que cette vision rejoint celle de beaucoup de Québécois, qui réalisent de plus en plus qu’il y a des limites à la culture du progrès et à ce qu’on peut imposer au territoire. »

L’intérêt des Québécois pour l’histoire et l’héritage de cette Première Nation ne date pas d’hier. « Dans les années 1970, des cinéastes et des anthropologues, comme Pierre Perrault, Rémi Savard et Serge Bouchard, ont joué le rôle de médiateurs ou d’interprètes culturels en étant les premiers à se montrer curieux envers le mode de vie et les mythes fondateurs des Innus, dit Marie-Hélène Jeannotte, chercheuse postdoctorale à l’Université Queen’s. Ils ont contribué à révéler la richesse culturelle de cette communauté. »
En 1976, en traduisant les écrits d’An Antane Kapesh, l’ethnolinguiste José Mailhot fait de Je suis une maudite sauvagesse la première œuvre innue publiée au Québec. Quelques années plus tard, toute la francophonie tombe sous le charme du groupe folk Kashtin, formé par Florent Vollant et Claude McKenzie. Leur premier album, lancé en 1989, s’écoule à près de 200 000 exemplaires et leur vaut deux prix Félix au Gala de l’ADISQ. La crise d’Oka, en 1990, jette toutefois de l’ombre sur leur succès. « Kashtin était la promesse d’un chemin vers la reconnaissance pour nous, affirme Natasha Kanapé Fontaine. Mais tout s’est arrêté avec la crise. J’ai l’impression que nous sommes 30 ans en retard dans notre rendez-vous avec la société québécoise. On reprend tranquillement là où l’on s’était séparés. »
Il aura fallu le charisme, la douceur et la résilience d’une Joséphine Bacon pour que les Québécois tendent de nouveau l’oreille, et le cœur. En 2010, son recueil Bâtons à message / Tshissinuatshitakana (Mémoire d’encrier, 2009) reçoit le Prix des lecteurs du Marché de la poésie de Montréal, ce qui ouvrira la voie à plusieurs jeunes auteurs de la relève.
« Les Innus sont aussi très proactifs dans la préservation et la diffusion de leur culture », soutient Marie-Hélène Jeannotte, qui est également chargée de cours à l’Université de Sherbrooke. « On peut penser à l’Institut Tshakapesh, qui œuvre à la sauvegarde de la langue et des savoirs ancestraux, mais aussi à divers événements qui mettent en valeur la littérature orale, tels que le Festival du conte et de la légende de l’Innucadie et le festival Innu Nikamu. »
L’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi que la découverte de sépultures non marquées à proximité des pensionnats pour Autochtones ont mené à une curiosité encore plus vive ces 10 dernières années. Selon Michel Jean, c’est lorsque la réalité a dépassé la fiction que les Québécois ont vraiment ressenti le besoin de se tourner vers elle. « En septembre 2020, Joyce Echaquan a mis un visage sur les injustices que subissent les Autochtones au quotidien. Je lui suis extrêmement reconnaissant d’avoir mis en lumière une réalité que peu de gens avaient le courage de regarder en face. Je reçois chaque jour une dizaine de messages de lecteurs qui souhaitent que les choses changent. Sa mort a ouvert un chemin vers la tolérance. »