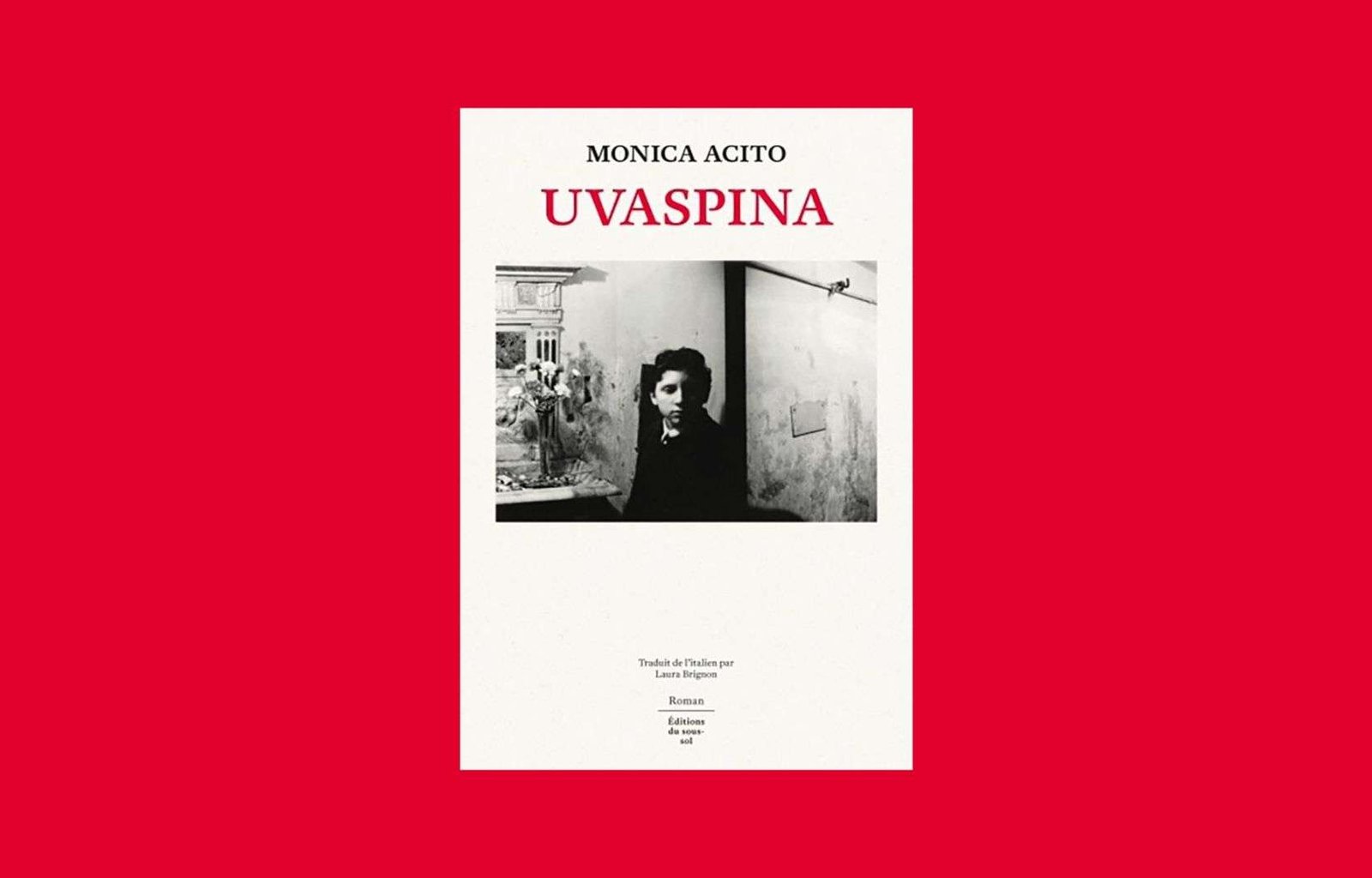Les villes ont une âme. Certaines ont une âme plus bigarrée ou plus noire, ou plus magnétique que d’autres.
Celle de Naples, par exemple, est particulièrement complexe. Elle palpite dans le ballet étourdissant des mobylettes, des chats errants et des vendeurs de rue, dans les traces d’un passé florissant qui reprend forme dans le crime et dans la crasse, dans les odeurs de friture et d’encens. Dans quelque chose aussi de plus profond, peut-être, qu’il faut chercher dans les entrailles de la ville, du côté des catacombes et de sa mythologie millénaire.
Dans Uvaspina, le premier roman de Monica Acito, un livre baroque, charnel, imagé, la ville de Naples est comparée à la tête d’un poulpe, un lieu où tout converge. Dans Chiaia, l’un des quartiers les plus riches de Naples, qui « poussait vers le haut et vivait sur la pointe des pieds », les nouveaux drames ont des racines profondes.
Et tout comme pour Naples, le temps de la splendeur de Graziella, dite la Dépareillée, est loin. Quand cette ancienne pleureuse professionnelle, née pauvre dans les quartiers bas de la ville, était encore « une touffe d’herbes folles, le pistil d’une nouvelle fleur ensorcelante, le corps de la ville qui se dénudait » et s’offrait sans honte. À présent, sa beauté étant fanée, elle est devenue une mère caractérielle et désœuvrée, un peu matrone, qui cultive d’une autre façon « l’art de la chiale et de la gruge » et fait croire une fois par semaine à ses enfants qu’elle est mourante.
Le père, Pascale Riccio, gère avec nonchalance ses entreprises, dilapidant avec constance l’héritage familial tout en vidant la petite caisse du cercle nautique dont il est président pour alimenter ses dépenses avec maîtresses et prostituées.
À l’ombre de ce couple mal assorti qui craque de partout, dans « l’air brûlant des statues de christs et de diables », Uvaspina et Minuccia forment une fratrie aux humeurs sanguines et complexes, unis l’un à l’autre comme ce qui les retient à Naples, une sorte de douleur collante et immémoriale. « Chaque mot entre eux, aussi muet fût-il, était plus vrai que toute chose, plus vrai que le grand corps de Naples. »
Adolescent imberbe à la peau de porcelaine, presque translucide, sous laquelle se donnent à voir ses veinettes bleues — comme la peau de la groseille qui lui a donné son surnom : uvaspina —, Carmine fait honte à son père, qui ignore royalement ce fils qui ne lui ressemble en rien. Sa sœur, la « foltoupie », éclate régulièrement en crises violentes et incontrôlables.
L’adolescent efféminé et solitaire, lecteur de poésie, martyr préféré de sa sœur à demi-folle, sera un jour secouru par un jeune pêcheur aux yeux vairons alors qu’il tentait mollement de se noyer dans la mer. Ils vont développer une relation torride, animale, avant que Minuccia — que son père cherche désespérément à marier — n’entre à son tour dans la danse.
Dans une Naples un peu hors du temps, où de toute façon « la chronologie n’existe pas », coincée entre la mer et le soleil, Monica Acito, née en 1993, donne avec Uvaspina une chronique familiale étouffante et sensuelle, pleine de cruauté et d’éclats de beauté. Un tour de force qui nous envoûte et laisse des traces.
Un passé qui ne passe pas
S’inspirant d’un féminicide qui a défrayé la chronique en 1997 dans les Abruzzes (connu comme le Delitto del Morrone), qui avait secoué toute l’Italie, Donatella Di Pietrantonio nous revient avec son roman le plus social et le plus politique, couronné l’année dernière par le prix Strega, l’équivalent italien du Goncourt.
S’écartant un peu de l’extrême fragilité des relations familiales et de la puissance des non-dits dont elles se nourrissent, l’autrice de Borgo Sud (Albin Michel, 2023) soupèse dans ce nouveau roman, dédié « à toutes les survivantes », le poids du territoire et de la mémoire collective.
La narratrice de L’âge fragile, Lucia, une physiothérapeute récemment séparée de son mari, voit revenir à la maison en pleine pandémie sa fille, étudiante à Milan. Mais elle ne reconnaît plus l’adolescente assombrie, taciturne, renfermée qu’elle est devenue. « Milan m’a rendu une fille éteinte », constate-t-elle sans comprendre.
La splendeur qui règne au pied du Dente del Lupo, le sommet qui domine les environs, a été assombrie vingt-cinq ans plus tôt par la mort sordide et tragique de deux sœurs, des touristes randonneuses. La seule survivante du drame, la meilleure amie de Lucia à l’époque, a émigré au Canada. Le meurtrier était un berger silencieux et sans histoire qui voulait violer l’une d’entre elles.
Dans la petite localité, depuis, chacun essaie comme il peut d’oublier cette histoire. Le camping a fermé. Les gens se taisent. Le vieux père de Lucia, qui en était copropriétaire, souhaite aujourd’hui lui léguer les terres qu’il possède à l’ombre de la « Dent de loup ». Mais comment exorciser le passé si les nouvelles générations n’en savent rien ?
Donatella Di Pietrantonio, elle-même originaire des Abruzzes, reprend ici avec force et avec finesse certains thèmes de ses romans précédents, notamment ceux du retour, des non-dits et des relations mère-fille, comme dans La revenue (Seuil, 2018), qui lui avait valu le prestigieux prix Campiello.
L’âge fragile
★★★1/2
Donatella Di Pietrantonio, traduit par Laura Brignon, Albin Michel, Paris, 2025, 272 pages
Uvaspina
★★★★
Monica Acito, traduit par Laura Brignon, Sous-Sol, Paris, 2025, 464 pages
À voir en vidéo
[...] continuer la lecture sur Le Devoir.