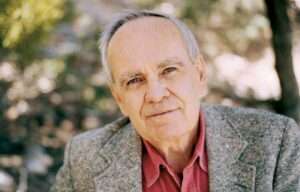Le Devoir du 11 août 1945 annonce en une « La fin de la guerre attendue incessamment », citant les effets de l’utilisation des bombes atomiques contre Hiroshima et Nagasaki quelques jours plus tôt.
En page huit, un texte du père Paul-Aimé Martin fait référence au projet de l’École des bibliothécaires d’établir un réseau catholique de bibliothèques au Québec dans ce nouveau monde bientôt en paix. « Nous ne voulons pas d’un enseignement neutre, dit le directeur de la maison d’édition Fides. Rappelons-nous qu’il faut craindre, pour les mêmes raisons, les bibliothèques neutres. »
L’École des bibliothécaires a été fondée en 1937 pour concurrencer en français la formation donnée par l’Université McGill depuis des décennies. L’établissement sera totalement restructuré en 1961 en devenant partie intégrante de l’Université de Montréal (UdeM) sous le nom d’École de bibliothéconomie. L’idée multicentenaire du bibliothécaire comme censeur sera alors vite abandonnée.
« L’École des bibliothécaires a enseigné jusqu’au début des années 1960 comment appliquer la censure et respecter les livres à l’index pour s’assurer de n’offrir sur les rayons que de “bons” livres, entre guillemets », explique Michèle Lefebvre, bibliothécaire aux collections patrimoniales à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), elle-même diplômée de cette école spécialisée de l’UdeM.
En 1883, l’évêque de Québec affirmait dans une conférence qu’« il y a plus de folie et de crime à lire un mauvais livre qu’à se flamber la cervelle ». Un mauvais livre était donc un poison, et l’Église en offrait l’antidote.
Mme Lefebvre profite de la Semaine des bibliothèques publiques, qui a cours jusqu’au 21 octobre, pour exposer des documents liés à la pratique concrète de la censure. L’historienne du livre publie aussi sur le site de son institution une analyse intitulée Les bibliothèques face à la censure. De l’index au libre choix.
« J’ai voulu montrer comment les bibliothécaires d’autrefois pensaient la censure et l’appliquaient dans leur travail. Les collections de livres étaient beaucoup contrôlées par le clergé ultramontain et l’élite conservatrice », explique-t-elle.
Mis à l’index
La chape de plomb va peser sur l’accès aux imprimés de l’apparition de la première bibliothèque publique francophone et catholique au milieu du XIXe siècle (l’Oeuvre des bons livres des Sulpiciens, en 1844) jusqu’à la
[...] continuer la lecture sur Le Devoir.