Paru en premier sur (source): journal La Presse
Avec Les yeux clos, son captivant deuxième roman, Philippe Yong pose un regard d’une cynique lucidité sur les conditions de production de l’information et sur ceux qui la mettent en forme. Entretien avec un accro aux journaux.
Publié à 7 h 00
« Je fais partie de ces gens un peu malades », dit Philippe Yong, que nous rencontrons dans la lumineuse succursale outremontaise de la Librairie du Square. Le regard vif de l’écrivain fier, et surtout soulagé, d’avoir atteint le fil d’arrivée, le jeune quinqua semble pourtant pétant de santé. C’est que son affliction, c’est l’information. Nul besoin d’appeler l’ambulance. On rit.
« Comme romancier, c’est pas mal, parce que ça donne des idées, explique-t-il, mais c’était aussi une routine qui n’avait plus de sens, de lire mécaniquement La Presse, le New York Times et Le Monde. Je dévorais de l’info au kilomètre et, de plus en plus, ça m’éloignait de la littérature. Je me faisais manger par le flux. »
Le personnage de son deuxième roman, Alex Delcourt, est lui aussi à la merci de cette succession ininterrompue, et aliénante, de nouvelles.
En tant que journaliste d’agence, le scribe doit chaque nuit ramasser en 200 lignes maximum les évènements qui représentent autant de tournants tragiques dans la vie de vraies de vraies personnes.
La contemplation au Musée d’Orsay d’une toile d’Odilon Redon, Les yeux clos (1890), lui procurera ce qui ressemble beaucoup aux effets épiphaniques du syndrome de Stendhal. Mais s’agirait-il plutôt d’une crise de la quarantaine à retardement ? Peu importe : le portrait de cette femme l’arrachera presque d’un coup à la torpeur dans laquelle il s’engluait. Il partira à la rencontre, un peu partout sur la planète, des humains qui se cachent derrière certains des faits divers qu’il a résumés en trop peu de mots.
PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE
Philippe Yong

Comme avec Hors-sol, son brillant premier roman dans lequel Alvare, son personnage principal, tentait de se réfugier du tumulte du monde en s’enfermant dans sa serre, Les yeux clos questionne la possibilité même d’une vraie rencontre avec l’autre ainsi qu’avec soi-même. D’une existence sans compromis, menée au diapason de ses envies et, surtout, de ses valeurs.
Assis devant une petite pile de ses livres, Philippe Yong se remémore la citation de Virginia Woolf : On ne trouve pas la paix en fuyant la vie.
« Chez Alvare, se remémore-t-il, il y avait l’illusion du microcosme : “Je vais me faire mon petit univers et le monde et ne frappera pas à ma porte.” Et puis chez Alex, il y a le désir de replonger dans une sorte de vraie matière humaine et ça marche momentanément, mais je ne sais pas si on peut complètement échapper à la machine. »
La machine ? Celle à cause de laquelle un journaliste est parfois tenté de céder à l’appel de la bonne histoire, quitte à négliger des considérations de nature éthique, par exemple. « Il tente de l’humaniser, la machine. La tentative est noble, peut-être qu’elle suffit. Mais il y a toujours le problème de la récupération. Le monde va toujours finir par frapper à la porte. Le flux finit toujours par nous rattraper. »
L’homme augmenté diminué
En s’inspirant de véritables faits divers, et en suivant son personnage d’Alex dans ses reportages, Philippe Yong dresse le portrait-charge d’une époque asservie à ses technologies. C’est l’histoire d’Ethel, qui s’est enlisée dans une piste de sable, parce que son GPS lui indiquait qu’il y avait là un chemin plus direct vers Las Vegas. Ou celle des résidants de Green Bank en Virginie-Occidentale, un village refuge, sans Wi-Fi ni ondes radio, pour personnes électro-hypersensibles.
« C’est burlesque de s’engager sur un pont quand on voit la marée monter, juste parce que le GPS nous dit d’y aller », lance Philippe Yong, en évoquant un autre évènement qui s’est passé pour vrai. « Mais c’est aussi tragique. »
Né en France de parents d’origine coréenne, le Québécois d’adoption enseigne la littérature au Collège Stanislas, où il a réfléchi avec ses élèves cette année à la figure de l’homme augmenté, présente dans nombre de romans d’anticipation. « Et je leur dis toujours : “Faites attention, si on peut augmenter l’homme, on peut le diminuer.” Il y a un abandon de souveraineté humaine qui me paraît comme un de nos grands problèmes. »
Les yeux clos soupèse aussi la question hypercontemporaine d’à qui appartiennent les histoires. À ceux qui les ont vécues ou à ceux qui souhaitent les raconter ? La pureté des intentions excuse-t-elle tout ?
« Ce sont des interrogations qui m’ont habité moi-même, surtout vers la fin du livre », dit l’auteur au sujet d’un passage où Alex sera appelé à produire un reportage sur des enfants qui souffrent du syndrome de résignation, un mal aussi curieux que troublant observé chez des réfugiés, qui s’enfoncent dans une forme de coma.
« Est-ce que j’ai, comme romancier, le droit de parler de ces tragédies-là qui sont réelles, même si je les transforme, même si je le fais avec empathie ? Je n’ai pas l’impression que le roman donne une licence absolue, comme on l’a longtemps pensé. »
Le roman aura en tout cas fourni un apaisement à la surdose d’informations qui minait Philippe Yong. « Le remède, conclut-il avec un sourire en coin, c’est peut-être de lire des livres après avoir lu le journal. » Ou même d’en écrire.
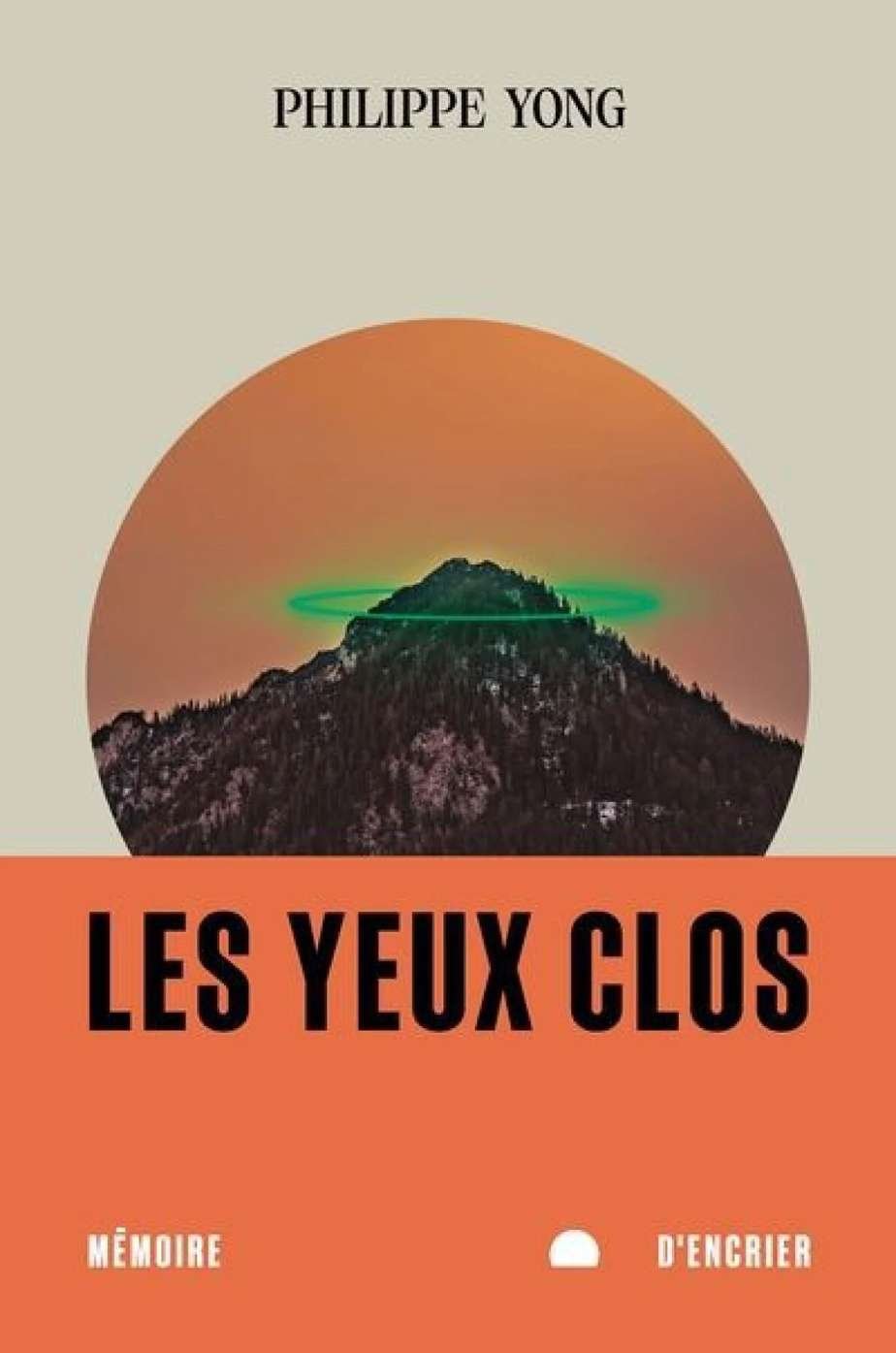
Les yeux clos
Mémoire d’encrier
262 pages



