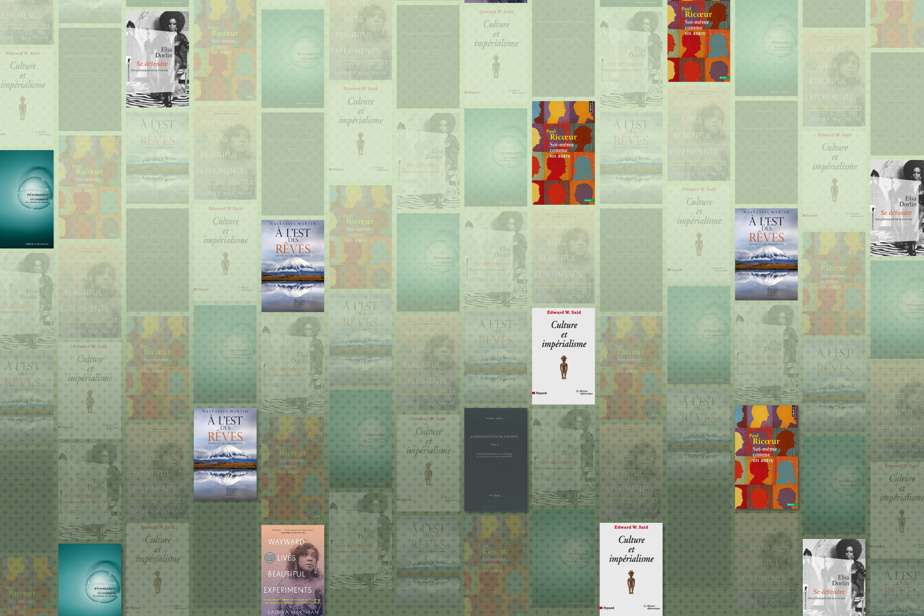Paru en premier sur (source): journal La Presse
Publié à 8h00 Jérémie McEwen collaboration spéciale Frédérique Bernier
PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE
Frédérique Bernier
Elle déconstruit ses sujets de réflexion comme elle déconstruit l’âme de ses lecteurs.
« L’œuvre de l’anthropologue Nastassja Martin embrasse des enjeux collectifs majeurs à partir de l’expérience la plus intime, celle du corps altéré, explique Frédérique Bernier. Dans À l’est des rêves. Réponses even aux crises systémiques, Martin décrit le devenir d’une famille autochtone even, un peuple nomade, ayant décidé de se réinstaller, après la chute du régime soviétique, dans la forêt sauvage du Kamchatka. Le collectif réinvente un mode de vie à la fois ancien, parce que puisant dans les savoirs ancestraux, et inédit, parce qu’émanant des bouleversements politiques, économiques et environnementaux en cours. Il devient ce laboratoire d’où surgissent des pistes pour façonner ce rapport transformé au vivant qui est notre avenir. »
À l’est des rêves. Réponses even aux crises systémiques
Nastassja Martin
Éditions La découverte
296 pages
Jacques Beauchemin
PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE
Jacques Beauchemin
Il est à l’origine du renouveau conservateur québécois, mais est plus modéré que certains de ses élèves (Mathieu Bock-Côté à leur tête).
« Les individus vivent leurs relations mutuelles à travers des valeurs comme le devoir, la sollicitude, le respect, etc., souligne Jacques Beauchemin. Mais la société est-elle absente de ce qui semble ne concerner que les relations de un à un ? Soi-même comme un autre propose une réponse. Ricœur écrit que l’essence de l’éthique réside dans « le désir de vivre bien avec et pour les autres dans des institutions justes ». Il s’agit donc d’articuler le rapport éthique qui s’établit entre les individus au rôle de sanction joué par les institutions sociales. Les « institutions justes » sont essentielles dans cette approche : c’est à travers elles que la relation intersubjective peut se projeter en une éthique collective. »
Soi-même comme un autre
Paul Ricœur
Du Seuil
448 pages
Mathieu Bélisle
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE
Mathieu Bélisle
Auteur et professeur, il est présentement le meilleur candidat pour devenir le Serge Bouchard de demain.
« Lire Anders : un des évènements majeurs de ma vie d’écrivain, affirme Mathieu Bélisle. Chez cet intellectuel, l’euphorie suscitée par les avancées modernes fait place à une lucidité inquiète : les développements technologiques placent l’humanité devant une possibilité inouïe, celle de sa propre disparition. Critique féroce du fascisme, Anders se demande si l’avènement de la société des loisirs, promesse-phare du capitalisme, ne cache pas une volonté d’asservissement, si le temps “libre” n’est pas rempli par des formes déguisées de travail. Située entre littérature et philosophie, son œuvre refuse moins le changement qu’elle ne l’interroge, plaidant pour que le monde ne change pas sans nous. »
L’obsolescence de l’homme (tomes 1 et 2)
Günther Anders
Ivrea/Fario
Philippe Néméh-Nombré
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE
Philippe Néméh-Nombré
Il réfléchit aux identités métissées et à leurs promesses de nouveauté pour le Québec.
« Hartman explore la promesse que chuchote l’archive de la violence – les promesses dont la texture se révèle lorsque s’épuisent, au bout de leur capture, les archives de la violence. Philadelphie, New York, le début du XXe siècle et de jeunes femmes noires qui fabriquent ce qui pourrait être autrement, en travers de l’oppression. À partir d’un impressionnant travail archivistique, Hartman écrit l’interruption, écrit dans l’interruption, avec elle : ces imaginations et pratiques radicales, érotiques, ordinaires. Sur le coin d’une rue, dans une chambre, au cabaret. Ce qui ne peut pas se raconter se raconte dans la beauté. »
Wayward Lives, Beautiful Experiments: Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals
Saidiya V. Hartman
W. W. Norton
441 pages
Mélikah Abdelmoumen
PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE
Mélikah Abdelmoumen
Elle a mis un point final au débat sur l’appropriation culturelle au Québec dans son livre Baldwin, Styron et moi.
« Edward W. Said, grand intellectuel palestino-américain, relit ici les classiques de la littérature occidentale depuis sa propre position de “frontalier”, mais sans pour autant oublier le contexte dans lequel ils ont été écrits, indique Melikah Abdelmoumen. Il ne s’agit pas de nier qu’à leur façon, en leur temps, ces auteurs et autrices ont contribué à l’avènement d’un monde plus juste, mais de considérer avec un regard conscient de l’impérialisme et de ses effets leur manière de penser leur monde, de l’habiter et de l’écrire en tant qu’êtres à la fois d’exception, et bien de leur temps, de leur lieu. »
Culture et impérialisme
Edward W. Said
Fayard
560 pages
Mustapha Fahmi
PHOTO FOURNIE PAR MUSTAPHA FAHMI
Mustapha Fahmi
Il réfléchit et vit dans l’élégance cultivée, comme vision du monde à part entière.
« Avec la “résonance”, Hartmut Rosa propose un nouveau concept pour remédier à “l’accélération” qui caractérise la société moderne, explique Mustapha Fahmi. La vitesse n’est pas forcément mauvaise ; elle le devient quand elle conduit à l’aliénation. Lorsque notre rapport aux personnes et aux choses qui nous importent perd son sens, nous plongeons dans l’aliénation, voire dans la dépression. La résonance est une manière d’entrer dans une nouvelle relation au monde. Pour y parvenir, il faut rendre au monde son altérité, son étrangeté et son indisponibilité. Un monde où tout se ressemble, où tout est familier et où tout est disponible est