Paru en premier sur (source): journal La Presse
Didier Eribon est le théoricien de l’autofiction et des transfuges de classe. Le philosophe français, dont le livre Retour à Reims est notamment cité par Jean-Philippe Pleau (Rue Duplessis), explique sa démarche dans Sociobiographie, paru plus tôt cette année en même temps que le format poche du livre sur sa mère, Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple.
Publié à 9 h 00
Comment définir la notion de transfuge de classe ?
C’est une notion très difficile. C’est un individu qui change de classe sociale. J’ai grandi dans un milieu défavorisé, très, très pauvre dans mon enfance, avant de fuir Reims pour aller vivre à Paris parce que je voulais vivre librement la vie gaie. À Reims, je vivais dans un milieu très homophobe.
J’y ai rencontré un milieu plus favorisé, la bourgeoisie culturelle. Mes études m’éloignaient de ma famille. Dans mon milieu ouvrier, la culture n’existait pas. J’avais conscience que je n’étais pas fidèle, pas loyal. Mais j’ai fui et j’en étais heureux.
Quand on passe d’une classe à l’autre, on a un sentiment de honte du milieu d’où on vient. Ce n’est pas un sentiment psychologique, c’est l’effet d’une structure sociale d’infériorisation. Aussi, on a honte d’avoir honte. Le mot trahison m’est venu presque spontanément dans Retour à Reims.
Quand je suis arrivé à Paris, j’avais aussi l’accent du nord-est de la France, de la Champagne. Les mots que j’employais n’avaient pas de sens, on se moquait de mon accent. Il m’a fallu réapprendre à parler. Au Canada, Annette Boudreau a parlé de ce phénomène de la langue minoritaire.
Qu’est-ce qui vous a poussé à publier Retour à Reims en 2009 ?
Quand je suis parti de Reims pour étudier à l’université, j’ai quasiment cessé de voir ma famille. Je déjeunais avec mes parents quand ils venaient à Paris voir ma grand-mère, je téléphonais de temps en temps à ma mère. Ensuite, je ne les ai pas vus pendant 30 ans.
Quand mon père en mort en 2006 après avoir été dans une clinique d’alzheimer, je suis allé voir ma mère. Elle me racontait beaucoup de choses sur sa vie, celle de mon père, leur vie commune. Un jour, elle m’a dit : « Si je savais écrire, j’écrirais un livre sur ma vie. » C’est un peu parti d’une phrase de ma mère.
Pourquoi dites-vous que Retour à Reims est de la sociobiographie plutôt que de l’autofiction ?
C’est une manière de réfléchir sociologiquement, intellectuellement et littérairement sur les réalités du monde social, à travers les vérités de notre histoire. J’ai toujours lié la réflexion autobiographique, l’auto-analyse, à la réflexion sociologique plus théorique.
Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple n’est pas un livre sur ma mère en tant que personne singulière, mais en tant que personnage sociologique. Ce que Balzac appelait les types sociaux. Mon éditeur néerlandais a demandé d’utiliser le titre Vie et mort de ma mère et j’ai dit non.
Pourquoi votre mère est-elle la seule de votre famille immédiate avec laquelle vous avez gardé contact ?
Adolescent, je n’ai jamais réussi à avoir une conversation avec mon père. Je l’ai toujours détesté, ce n’était pas quelqu’un avec qui on pouvait parler, pas quelqu’un qui parlait, qui réfléchissait. Ma mère était plus intelligente, plus ouverte.
Ce qui m’unissait à elle est très difficile à définir. Ce n’est pas de l’amour. Peut-être de la compassion pour cette vieille femme, dont le corps a des douleurs à tous les niveaux parce qu’il a été détruit par sa vie de travailleuse.
Elle travaillait en usine pour que je puisse aller lire Kant à l’université. Je dois être reconnaissant et m’occuper d’elle. En même temps, j’avais des sentiments ambivalents à cause de son racisme obsessionnel qui était insupportable. Des fois, je me disais : qu’est-ce que je fais là ?
Je n’ai pas non plus de rapports avec mes frères. Après avoir quitté Reims, j’ai croisé une fois un de mes frères quand ma mère a été hospitalisée une dizaine d’années avant sa mort, et un autre quand nous avons installé notre mère dans une maison de retraite au nord de Reims. L’un de mes frères est mort récemment et je l’ai su quelques mois après, quand Facebook m’a proposé un post de sa compagne parce que nous avons le même nom.
Vous déplorez dans Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple le rapide déclin de votre mère une fois en maison de retraite.
Quand ma mère est entrée dans une maison de retraite publique, le médecin, une femme très compétente, m’a dit : « Faites attention, quand ils entrent en maison de retraite, ils sont en très grand danger. » Je n’ai pas compris. Ma mère marchait difficilement, mais elle parlait sans problème.
Je me disais que j’irais la voir deux, trois, quatre ans, quelques fois par mois. Mais au téléphone, j’ai constaté un déclin rapide. Sept semaines plus tard, elle était morte.
Le personnel était largement insuffisant, personne ne venait changer sa couche quand elle sonnait, elle avait une douche par semaine. J’ai voulu faire entendre la parole à ces personnes qui ne peuvent pas descendre dans la rue manifester. Elles sont enfermées dans leur chambre, elles se plaignent à leurs enfants. Il n’y a pas de mobilisation possible.
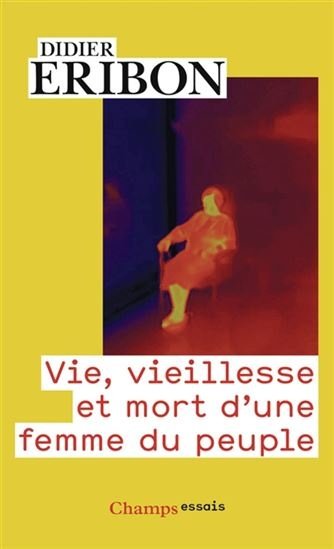
Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple
Champs
328 pages
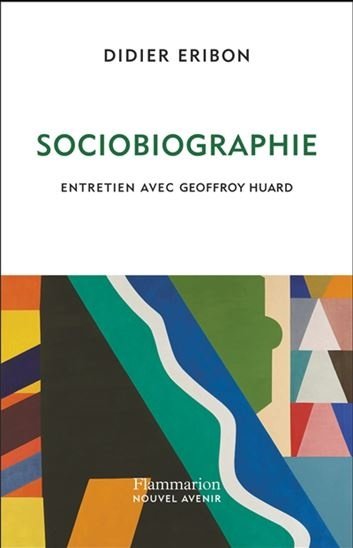
Sociobiographie
Flammarion
331 pages



