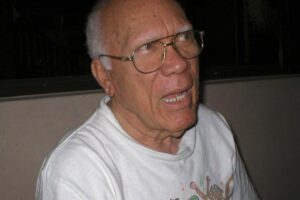Lucien travaille dans une librairie de livres usagers, commerce partageant le même local qu’un concessionnaire automobile. Ce n’est là qu’une des nombreuses caractéristiques insolites de la réalité propre au film Vil et misérable, de Jean-François Leblanc, d’après la bande dessinée de Samuel Cantin. L’élément le plus frappant, cela dit, tient au fait que Lucien est un démon. Ce qui ressemble à un costume d’Halloween bon marché est ainsi l’apparence réelle de ce rescapé des enfers : un être taciturne et misanthrope. Or, voici que la patronne de Lucien lui adjoint un jeune assistant, Daniel. Dès lors, oui, le diable est aux vaches. Réalisateur primé en court métrage, Jean-François Leblanc discute de son tout premier long.
« J’ai lu la bande dessinée après que quelqu’un m’a dit : “Tu devrais lire ça. C’est ton genre d’humour”, se souvient Jean-François Leblanc. C’était peut-être la première fois que je lisais un truc qui me faisait rire et non juste sourire. J’ai ri fort. Je reconnaissais un peu mon style de blagues. Mes premiers films à l’université avaient beaucoup ce rapport au réalisme magique, avec plein de petits éléments fantastiques qui colorent le réel. »
S’il ne perçut pas d’emblée un récit transposable en scénario, Jean-François Leblanc n’en fut pas moins convaincu qu’il y avait là matière à cinéma.
« La structure du livre est plus anecdotique. Mais je voyais tout un monde, je discernais un potentiel de fou… Et puis, pour moi, c’était clair depuis longtemps que mon premier long métrage, ça allait être une comédie, parce que c’est un genre dans lequel je suis confortable. »
Le cinéaste avoue avoir mis plus d’un an avant d’approcher Samuel Cantin.
« Un jour, j’ai vu passer une entrevue avec lui, dans le journal. C’est là que je me suis décidé à entrer en contact avec lui. Sachant, par l’article, qu’il avait un background en cinéma et qu’il préférait même l’écriture au dessin, quand je lui ai parlé, je lui ai tout de suite dit : “J’aimerais ça qu’on écrive le scénario ensemble.” Je ne sais pas si ça l’a rassuré, mais en tout cas, ça lui a plu. »
Des passages du livre furent repris et « augmentés » : par exemple, ce nouveau libraire, Daniel (Pier-Luc Funk), que Lucien (Fabien Cloutier) prend d’emblée en grippe. Dans la bande dessinée, il ne s’agit pas de la trame principale, tandis que dans le film, cette relation est au cœur de l’intrigue, dixit Jean-François Leblanc.
« On a repris les codes de la comédie policière, où il y a toujours deux policiers qui ne s’aiment pas, mais qui doivent faire équipe, et qui deviennent finalement des amis. On a mélangé à ça des codes de la comédie romantique, pour une bromance… Le fil narratif s’est tissé comme ça. »
Un tas de détails mineurs issus du livre crûrent eux aussi en importance dans le film, parfois jusqu’à la création d’ajouts inédits.
« Je pense à la sous-intrigue concernant les vols de livres. En discutant, on est parti sur l’idée d’une mafia des livres. Mais s’il y a une mafia du livre, il y a un marché noir du livre, et donc, il y a forcément un genre de police du livre. Ah, mais cette police-là, ça pourrait être un ange, en opposition avec Lucien… »
De vraies personnes
Imprégné de ce réalisme magique déjà évoqué, le film repose sur un humour à la fois fantaisiste et absurde.
« Dans les dialogues de Sam, il y a un côté un peu edgy, un peu too much, un peu plus gros que la réalité, et c’est voulu. Ses dialogues restent quand même près d’une certaine réalité. »
Le film préserve cette qualité, qu’il revenait aux acteurs et actrices d’intégrer et de moduler dans leur jeu.
« Avec les comédiens, il fallait que chaque personnage ait sa couleur. Mais en même temps, il ne fallait pas qu’il y en ait un qui ait l’air d’exister dans un univers différent. Les comédiens ne devaient pas non plus forcer. Personnellement, en comédie, je ris beaucoup moins lorsque j’ai l’impression de regarder des clowns qui sont là pour me faire des jokes : après un bout, je me tanne. Il y a certaines sitcoms que j’aimais au départ, mais dont j’ai décroché parce que je ne voyais pas des vraies personnes avec des vraies quêtes. Pour Sam et moi, c’était important de grounder chaque personnage, même le psychologue [Alexis Martin] et la boss [Chantal Fontaine], qui sont plus éclatés. »
De poursuivre Jean-François Leblanc, l’idée n’était pas d’enchaîner les blagues en un feu roulant ininterrompu.
« Dans le film, ce sont des gags qui prennent deux, trois minutes à installer. D’ailleurs, avec Sam, on s’est vraiment donné comme défi de maintenir le fun : je trouve souvent qu’en comédie, lorsqu’on arrive au troisième acte, on n’a plus de fun. »
Pour autant, Jean-François Leblanc tenait également à ce que le public soit touché, de-ci, de-là.
« C’était une priorité que le spectateur rentre dans le film en riant, mais qu’il se surprenne à être impliqué émotionnellement, et même à être touché à la fin. »
Une réalisation réfléchie
Sur le plan technique, Jean-François Leblanc eut tout loisir de réfléchir à sa mise en scène. Quoique, comme il l’admet volontiers, une « vision » ne se soit pas imposée d’elle-même dès la première lecture de la bande dessinée.
« Sam et moi avons amorcé le processus d’écriture en 2016. Je t’avoue que les deux premières années, je ne savais pas encore à quoi le film ressemblerait. Quand j’ai tourné mon court métrage Landgraves, j’ai commencé à jouer un peu plus avec le langage classique du cinéma. Ça a ouvert une fenêtre dans ma tête, et à partir de là, ça s’est mis à être très clair. Pour être en phase avec le décalage fantastique de cet univers-là, j’allais recourir à un format d’image très large, en anamorphique, qui déforme juste un petit peu — j’avais en référence des compositions de films de John Carpenter, comme Assault on Precinct 13. Mes cadres, c’est beaucoup des plans d’ensemble et des plans moyens : il y a peu de gros plans. En comédie, un gros plan de visage, ça peut être drôle, mais il y a aussi toute la dimension physique et la gestuelle du corps qui peuvent l’être encore plus. »
Au sujet de la réalisation toujours, l’un des pièges du « premier long métrage » que Jean-François Leblanc sut éviter est celui de la surenchère formelle visant à épater la galerie, par insécurité, ou pour prouver qu’on a du talent. Lors du tournage, certains mouvements de caméra complexes furent ainsi abandonnés, le réalisateur, de concert avec son directeur photo, François Messier-Rheault, les jugeant à la réflexion inutilement tape-à-l’œil.
« À deux-trois jours du tournage, il est arrivé qu’on se dise : “Ouin, c’est niaiseux de faire ça. On n’est pas dans [la série] Euphoria où ça se met tout à coup à spiner pour rien.” Des fois, juste un beau cadrage, ça fait vraiment la job », résume Jean-François Leblanc.
La réalité rejoint la fiction
Il n’empêche, le cinéaste affirme s’être « gâté ». À ce propos, lorsqu’on lui demande ce qu’il conserve le plus précieusement de l’aventure, Jean-François Leblanc n’a guère besoin de réfléchir avant de répondre.
« Ça va sonner quétaine, mais ce qui se produit dans le film entre Lucien et Daniel, c’est ce qui est arrivé dans la vie entre Sam et moi. On ne se connaissait pas, mais ça a tellement été facile de travailler ensemble… On est devenus des amis, on a eu des enfants chacun de notre côté, on se parle depuis presque tous les jours, et là, on veut travailler sur un nouveau projet. J’ai trouvé dans ce gars-là un ami et un collaborateur qui va être là longtemps. »
En somme, ce fut une bromance derrière autant que devant la caméra.
Le film Vil et misérable prend l’affiche le 7 février.
À voir en vidéo
[...] continuer la lecture sur Le Devoir.